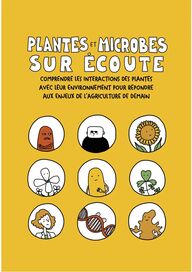
Return to flip book view
de Versailles une quipe de recherche de la Station de pathologie V g tale travaillait Al INRA l tude des relations entreune plantes l INRA de Versailles quipeet debact ries recherche de la Station de pathologie V g tale travaillait A l tude des relations entre plantes et bact ries Pseudomonas solanacearum aujourd hui nomm e Ralstonia solanacearum est une bact rie du sol pathog ne des v g taux Pr sente particuli rement dans les r gions tropicales et subtropicales Pseudomonas solanacearum aujourd huiElle nomm e Ralstonia solanacearum est une bact rie du sol bacelle infecte de nombreuses familles botaniques colonise le xyl me causant le fl trissement t rien de la tomate la pourriture brune de la pomme la maladie de Granvilleelle duinfecte tabac et la pathog ne des v g taux Pr sente particuli rement dansde les terre r gions tropicales et subtropicales maladiede denombreuses Moko du familles bananier botaniques Elle colonise le xyl me causant le fl trissement bact rien de la tomate la pourriture brune de la pomme de terre la maladie de Granville du tabac et la maladie de Moko du bananier Rhizobium meliloti est une bact rie du sol capable de fixer l azote atmosph rique que la plante peut ensuite m taboliser Une relation symbiotique se met en place dans des nodosit s form es Rhizobium meliloti est une de bact rie du sol capable de fixer l azote atmosph rique la plante peut de sur les racines certaines plantes la famille des L gumineuses telles que laque Luzerne le Soja la Lentille ensuite la F ve le Haricot le Pois m taboliser Une relation symbiotique se met en place dans des nodosit s form es sur les racines de certaines plantes de la famille des L gumineuses telles que la Luzerne le Soja la Lentille la F ve le Haricot le Pois n 1981 sous l impulsion de Pierre Boistard et Jean D nari le d m nagement vers la r gion toulousaine permettait de r unir sur un site unique des tudes sur cellules animales v g tales et 1981 sous h bergeait l impulsion de une Pierre Boistard Jean D nari o le l on d m nagement la r gion et la microbiennes nToulouse des seuleset universit s enseignait vers la g n tique biologie mol culaire techniques essentielles l tude des tudes interactions entre microorgatoulousainedeux permettait de r unir sur un site unique des sur cellules animales nismes v g tales et les plantes Le nouveau laboratoire LBMRPM Auzeville a t o d sl onson origine une et microbiennes Toulouse h bergeait une des seules universit s enseignait la unit mixte de recherche avec le CNRS Peu commune en 1981 cette association permettait g n tique et la biologie mol culaire deux techniques essentielles l tude des interactions entre d largir les mod les d tudes d autres organismes en accueillant une quipe dirig e par Pierre Yot microorganismes et les de plantes Le nouveau LBMRPM Auzevilleappartenance a t d s son INRA CNRS origine qui travaillait sur le virus la mosa que dulaboratoire chou fleur Cette double une unit mixte de recherche avec le CNRS Peu commune 1981 cette association a particip la dynamique et l volution du laboratoire quien a galement d velopp permettait de solides interactions aveclesles tablissements d enseignement place toulousaine UPS ENSAT d largir mod les d tudes d autres organismes de en la accueillant une quipe dirig e par PierreINSA Yot qui travaillait sur le virus de la mosa que du chou fleur Cette double appartenance INRA CNRS a particip la dynamique et l volution du laboratoire qui a galement d velopp de solides interactions avec les tablissements d enseignement de la place toulousaine UPS ENSAT INSA E E
L es plantes de la famille des l gumineuses peuvent s associer des bact ries du sol les rhizobia qui poss dent la capacit de fixer l azote atmosph rique Au laboratoire nous avons cherch comprendre le m canisme naturel de fixation d azote en tudiant une l gumineuse Medicago truncatula en interaction avec la bact rie symbiotique Sinorhizobium meliloti Un v ritable dialogue entre les deux partenaires en interaction a t mis jours Il repose sur l change de signaux mol culaires Les bact ries en pr sence de flavono des exsud s par les racines de la plante produisent des facteurs Nod Les facteurs Nod doivent tre reconnus la surface des cellules v g tales formant des poils absorbants sur les racines pour provoquer l envoi d informations aux autres cellules environnantes de la racine Une cascade de r actions mol culaires aboutit la formation d un nodule organe sp cifique dans lequel les bact ries se multiplient et entrent en symbiose avec la plante L effet b n fique des facteurs Nod en champ a t montr pour des plantes l gumineuses Des analyses g n tiques ont mis en vidence des tapes de signalisation similaires lors de la formation des endomycorhizes structures permettant la symbiose avec des champignons endomycorhiziens qui assurent la nutrition min rale de la plante Cette association s tablit au niveau des racines Les facteurs Myc produits par champignons endomycorhiziens favorisent le d veloppement des racines Pour aller plus loin Debell F et al Assignment of symbiotic developmental phenotypes to common and specific nodulation nod genetic loci of Rhizobium meliloti Journal of bacteriology vol 168 3 1986 1075 86 https doi org 10 1128 jb 168 3 1075 1086 1986 Lerouge P et al Symbiotic host specificity of Rhizobium meliloti is determined by a sulphated and acylated glucosamine oligosaccharide signal Nature vol 344 6268 1990 781 4 https doi org 10 1038 344781a0 Maillet Fabienne et al Fungal lipochitooligosaccharide symbiotic signals in arbuscular mycorrhiza Nature vol 469 7328 2011 58 63 https doi org 10 1038 nature09622
L es intrants chimiques regroupent les pesticides herbicides et les engrais min raux dont le nitrate d ammonium La synth se chimique de ce dernier partir d azote N atmosph rique requiert d importantes quantit s d nergies fossiles et leur utilisation excessive en agriculture est n faste pour l environnement pollution de l eau contribution au r chauffement climatique rosion de la biodiversit locale Les rhizobia sont capables de r aliser la m me transformation de l azote gazeux par un processus biologique Les champignons mycorhiziens peuvent collecter l azote et les autres min raux indispensables aux plantes comme le phosphore P et le potassium K de mani re plus efficace que les racines ne peuvent le faire gr ce au myc lium r seau de filaments tr s tendu qu ils forment dans le sol De nombreuses questions se posent pour pouvoir exploiter au mieux le potentiel de ces symbioses Comment une plante peut la fois abriter d importantes populations de microbes b n fiques tout en ne devenant pas vuln rable aux attaques de microbes pathog nes Comment sont r gul s les changes entre les plantes et les microorganismes symbiotiques pour qu ils soient quilibr s et b n fiques aux deux partenaires dans diff rentes conditions environnementales Peuton s lectionner des plantes la fois r sistantes aux pathog nes et formant des symbioses efficaces Les chercheurs et chercheuses du LIPME abordent ces questions diff rentes chelles de la mol cule aux cosyst mes en d cortiquant les m canismes mol culaires mis en jeux et leurs effets sur les organismes dans diff rents contextes environnementaux afin de contribuer au d veloppement d une agriculture davantage respectueuse de l environnement Pour aller plus loin Benezech Claire et al Medicago Sinorhizobium Ralstonia Co infection reveals legume nodules as pathogen confined infection sites developing weak defenses Current Biology CB vol 30 2 2020 351 358 e4 https doi org 10 1016 j cub 2019 11 066
L a mol cule d ADN contient l information n cessaire aux tres vivants pour survivre et se reproduire D terminer sa s quence c est dire l ordre d encha nement des nucl otides qui la constituent est donc utile pour savoir comment vivent et voluent les organismes Le s quen age d un g nome constitu de plusieurs millions de nucl otides ou milliards de nucl otides pour certaines plantes sup rieures ne prend sens qu associ un traitement informatique des donn es Ce traitement permet l annotation de chaque r gion d chiffr e dans le processus de s quen age et lui associe une fonction Sont ainsi identifi s les g nes qui codent pour les prot ines et d autres r gions ayant des fonctions de structuration du g nome ou de r gulation de l expression des g nes L am lioration de la qualit des donn es et de leur annotation permet de mieux appr hender la biodiversit des organismes vivants et r pondre aux enjeux de l agriculture de demain
L es maladies de plantes caus es par les pathog nes sont responsables des d g ts importants en agriculture Les pathog nes utilisent des effecteurs pour neutraliser les syst mes d alarme de la plante leur donner acc s aux ressources v g tales et causer la maladie Les plantes sont elles incapables de se d fendre seules Non tout comme les animaux elles poss dent un syst me immunitaire sophistiqu qui peut les prot ger efficacement de certains pathog nes Des quipes du LIPME ont identifi des m canismes immunitaires permettant la plante de d tecter les activit s toxiques des effecteurs La r ponse immunitaire est alors violente et cause la mort des zones infect es de la plante emp chant ainsi la progression du pathog ne Fin de l histoire Non co volution course l armement l histoire ne s arr te pas l nouveaux effecteurs et nouveaux syst mes d alarme se font cho Q uels sont les b n fices pour l agriculture Peut on envisager de diminuer les quantit s de pesticides gr ce la s lection de vari t s naturellement plus r sistantes aux maladies C est ces questions que nos recherches tentent de r pondre Pour aller plus loin Le Roux Cl mentine et al A receptor pair with an integrated decoy converts pathogen disabling of transcription factors to immunity Cell vol 161 5 2015 1074 1088 doi 10 1016 j cell 2015 04 025 Wang Guoxun et al The Decoy Substrate of a Pathogen Effector and a Pseudokinase Specify Pathogen Induced Modified Self Recognition and Immunity in Plants Cell host microbe vol 18 3 2015 285 95 doi 10 1016 j chom 2015 08 004 Bernoux Maud et al Connecting the dots between cell surface and intracellular triggered immune pathways in plants Current opinion in plant biology vol 69 102276 21 Aug 2022 doi 10 1016 j pbi 2022 102276
G lossaire Abiotique En cologie se dit d un facteur li l environnement et ind pendant des tres vivants Les facteurs abiotiques correspondent par exemple aux facteurs climatiques temp rature clairement hygrom trie vent Biotique En cologie se dit d un organisme vivant qui agit sur un autre tre vivant Il existe deux cat gories de facteurs biotiques ceux li s aux interactions intrasp cifiques entre individus d une m me esp ce et ceux li s aux relations intersp cifiques entre individus d esp ces diff rentes Changements climatiques D signent une modification durable des param tres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats r gionaux Le vent est caus par des diff rences spatiales de temp rature Il est donc d r gul par le r chauffement climatique Changements environnementaux Englobent des changements li s des processus intrins ques la Terre changements climatiques des influences ext rieures ou aux activit s humaines N crotrophe se dit d un agent pathog ne qui tue les cellules de l h te pour s en nourrir Perturbation environnementale Facteur environnemental biotique ou abiotique qui n est pas optimal pour la croissance et la production de biomasse d une plante comme une maladie la s cheresse R sistance un bioagresseur Capacit h r ditaire d une plante se d fendre contre un bioagresseur en bloquant ou en r duisant la capacit de multiplication y compris la reproduction du bioagresseur Synonyme d immunit au sens large Sensibilit d une plante Capacit h r ditaire d une plante tre infect e par un bioagresseur et exprimer des sympt mes de maladie Dans ce cas le bioagresseur est d clar virulent ou agressif Signal m canique Les cellules v g tales sont entour es d une paroi rigide compos e de sucres Comme les cellules sont remplies d eau cette paroi est en tension Les tensions dans les parois ainsi que les d formations associ es sont per ues par les cellules et int gr es dans la r ponse de la plante Ces m canismes de m canoperception participent la r gulation d un grand nombre de fonctions essentielles pour la plante comme la croissance et le d veloppement
C omment a marche Une cam ra multispectrale enregistre en une seule prise de vue une multitude de longueurs d onde pour effectuer diff rents types d analyses Elle capture de mani re non destructive dans diff rentes gammes de couleurs bleu rouge vert et proche infrarouge des images qui permettent de voir des d tails non visibles l il nu renseignant sur l tat du mat riel v g tal Le robot OmniLog est un incubateur automatis contenant une cam ra Il est capable d effectuer un criblage colorim trique haut d bit de 4800 exp riences en simultan es Il peut fournir des donn es concernant l identification des microorganismes et la caract risation de leur activit m tabolique dans diverses conditions environnementales diff rentes sources de carbone et d azote r sistance au stress pH osmolarit temp rature r sistance aux antibiotiques Des mesures effectu es toutes les 15 minutes permettent d tablir des cin tiques de comportement des bact ries sur plusieurs jours Les donn es sont stock es sur un serveur install au Data Center de l INRAE Occitanie Toulouse et leur gestion est assur e par le personnel de la plateforme TPMP
Q uizz Q1 Certains organismes b n fiques peuvent devenir pathog nes quand ils sont associ s certaines plantes Vrai Faux Q2 Lesquels de ces organismes ne sont pas des micro organismes La bact rie Escherichia coli Le champignon Sclerotinia La levure Saccharomyces L ponge Bob R ponses Q1 Vrai par exemple Pantoea agglomerans c est un agent de biocontr le de Xanthomonas campestris mais en m me temps un pathog ne d Arabidopsis thaliana Q2 Bob videmment La population de bact ries sur les plantes peut aller jusqu 107 cellules par cm2 de feuille Autant que d habitants au Portugal Vorholt JA Microbial life in the phyllosphere Nat Rev Microbiol 2012 Dec10 12 828 40 doi 10 1038 nrmicro2910 p 828 Pour aller plus loin Lannou C Roby D Ravign V Hannachi M Moury B 2021 L immunit des plantes Pour des cultures r sistantes aux maladies Editions Quae Bartoli Claudia et al In situ relationships between microbiota and potential pathobiota in Arabidopsis thaliana The ISME journal vol 12 8 2018 2024 2038 doi 10 1038 s41396 018 0152 7 Thiergart Thorsten et al Root microbiota assembly and adaptive differentiation among European Arabidopsis populations Nature ecology evolution vol 4 1 2020 122 131 doi 10 1038 s41559 019 1063 3
E n savoir plus Le pathog ne La souche de Ralstonia solanacearum utilis e au laboratoire cause le fl trissement bact rien de la tomate et de l aubergine Avec l volution exp rimentale elle est maintenant capable de coloniser le haricot et le choux Cela permet aux chercheurs de mieux comprendre l mergence de cette maladie sur de nouvelles plantes La symbiose fixatrice d azote Un symbiote naturel de la l gumineuse Mimosa pudica est le rhizobium Cupriavidus taiwanensis Ralstonia gr ce aux g nes symbiotiques de Cupriavidus et l volution exp rimentale peut maintenant induire la formation de nodosit s chez le mimosa dans lequel il se multiplie Pour aller plus loin Marchetti Marta et al Experimental evolution of a plant pathogen into a legume symbiont PLoS biology vol 8 1 e1000280 12 Jan 2010 doi 10 1371 journal pbio 1000280 Guidot Alice et al Multihost experimental evolution of the pathogen Ralstonia solanacearum unveils genes involved in adaptation to plants Molecular biology and evolution vol 31 11 2014 2913 28 doi 10 1093 molbev msu229 Perrier Anthony et al Enhanced in planta Fitness through Adaptive Mutations in EfpR a Dual Regulator of Virulence and Metabolic Functions in the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum PLoS pathogens vol 12 12 e1006044 2 Dec 2016 doi 10 1371 journal ppat 1006044 Capela Delphine et al Recruitment of a Lineage Specific Virulence Regulatory Pathway Promotes Intracellular Infection by a Plant Pathogen Experimentally Evolved into a Legume Symbiont Molecular biology and evolution vol 34 10 2017 2503 2521 doi 10 1093 molbev msx165
Q ue ce soit pour collecter des donn es ou participer plus activement aux exp riences les acteurs de la soci t contribuent produire et valoriser diff rentes formes de savoir et peuvent ainsi mieux appr hender la d marche scientifique ses contraintes sa rigueur Ces collaborations permettent de faire un lien entre la science et la soci t civile dans le respect des besoins et droits des diff rentes personnes impliqu es Un site regroupe les projets de science participative auxquels vous pouvez contribuer https www science ensemble org projets
m diatrice scientifique Apr s des tudes de biologie cologie elle s est sp cialis e dans la m diation en environnement et la communication scientifique L objectif de son travail est de rendre les contenus scientifiques accessibles et compr hensibles par des publics vari s en travaillant au plus pr s des chercheurs Elle r alise pour cela des bande dessin es explicitant conf rences ou articles scientifiques ou des illustrations les clairant par un regard d cal En direct ou a posteriori ces supports permettent de rendre appr hendable la connaissance scientifique par des non sp cialistes mais aussi de proposer un pas de c t ou de recul aux sp cialistes Cf https adelehuguet wordpress com